INTERVIEW SELOSSE
ENTRETIEN AVEC MARC ANDRE SELOSSE

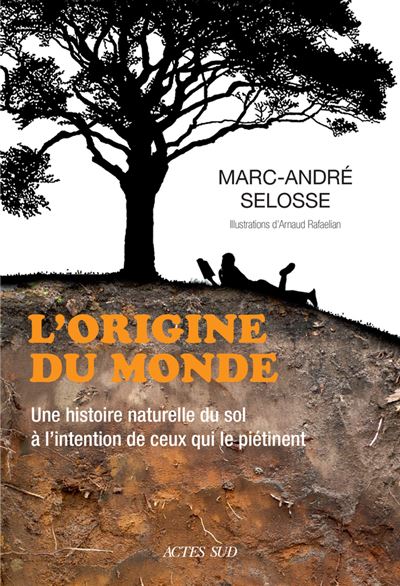
Propos recueillis par Pierre TROTIN
Chers amis, ce mardi 21 février 2023, belle aventure que celle de l’échange avec Marc-André SELOSSE. L’homme prend de l’importance, il attire l’attention dans les médias. Au moment de notre rencontre, au Jardin des Plantes à Paris, il est en séance photo dans la grande serre où se tient une expo temporaire d’orchidées. Très cordialement, il m’en ouvre les portes. L’improbable occasion m’est ainsi donnée de déambuler parmi des centaines de fleurs étranges et magnifiques d’une jungle tropicale en attendant mon interview !
Puis, en toute simplicité, Marc-André SELOSSE me propose de partager un repas frugal dans les locaux du Muséum National d’Histoire Naturelle. C’est là que se trouve son bureau, et nous déjeunons sur la table de réunion après avoir tendu une nappe. Il me propose une tasse de café, et m’invite à m’asseoir à son bureau.
Notre entretien commence :
– AIISA - Marc-André SELOSSE, dans votre livre « L’Origine du Monde », la dominante est profondément technique. Néanmoins, n’auriez-vous pas aimé en dire plus sur l’état des sols en particulier, et sur l’urgence en général de réviser notre rapport avec la nature ? En tout cas, on le sent très fort notamment dans le dernier chapitre.
– Marc André SELOSSE - Les problèmes affleurent tout de même dans le texte en général ! La perte en matière organique et la question des labours sont largement abordées en amont dans l’ouvrage. En revanche, là où vous avez raison, l’alarme ne retentit que dans le dernier chapitre. Je n’y raconte pourtant pas qu’une histoire, j’évoque un réel problème, qui a des conséquences sur notre façon de consommer et sur notre environnement. Et c’est très lié avec nos pratiques quotidiennes. A présent, si l’on pense à mes livres précédents, sur le microbiote[1]ou les tannins[2], et plus encore et à celui que je suis en train d’écrire, nous tombons sur des questions de santé. Clairement, toutes les questions relatives au microbiote exigent de revisiter les notions d’hygiène collective et individuelle, ainsi que les législations limitant la présence de microbes dans nos aliments qui imposent une pasteurisation généralisée, pour que finalement chacun finisse par s’inoculer… de façon contrôlée. Tout cela indique qu’il y a effectivement une dimension sociétale et sanitaire. Finalement, le sol n’est pas exempté par la façon dont on gère ces choses. Sur ces sujets, j’ai donné plus de 320 conférences l’année dernière par exemple !
– Ah oui quand même !
– C’est un véritable marathon, en effet, mais le but est bien de diffuser les idées, il ne s’agit pas juste vendre des livres !
– En somme, c’est un engagement ?
– Effectivement. D’ailleurs, pendant ces conférences, on s’aperçoit que les questions de la salle ne portent que (!) sur la partie de l’exposé qui invite à revisiter les pratiques. Et cela m’a donné à réfléchir. Ainsi, le prochain livre n’est pas un livre qui se justifie par les connaissances, avec les conséquences sur la pratique. Ce sera un livre qui souhaite revisiter complètement le rapport et les représentations que nous entretenons avec notre environnement et la nature – en attaquant nos idées reçues, souvent erronées.
– Eh bien, nous l’attendons ! La sortie est prévue pour quand ?
– A priori, ce serait en janvier prochain[3]. C’est un livre conçu en une dizaine d’essais, dont chacun déconstruit une représentation fallacieuse de la nature. Il tente de reconstruire autre chose, avec l’homme au milieu, et en cohérence avec ce que l’on voit dans la recherche actuelle.
– Pourriez-vous nous citer un exemple ?
– Tout à fait, plusieurs même ! Par exemple, le discours selon lequel il faudrait effectuer une « transition ». Ce n’est pas vrai. Ce qu’il faut, c’est évoluer. Évoluer culturellement, et biologiquement, mais surtout culturellement d’ailleurs, et perpétuellement. Autre exemple, on entend souvent dire : « la nature est bien faite ». Eh bien non ! Elle est faite de ce qui survit, et l’évolution, ça ne sélectionne pas que des choses bien faites. Et encore : « l’homme est l’égal de la femme ». Encore une fois non ! Ça peut se construire, ça doit se construire, mais pour le construire, il faut déjà comprendre les différences objectives. Ainsi, lorsque l’on affirme une identité entre les deux, en réalité on abîme complètement les femmes. Prenez l’exemple des posologies médicamenteuses, elles ont été établies sur des hommes. Elles sont unisexes, et donc, selon les cas, on est en surdosage ou sous-dosage pour les deux tiers des médicaments prescrits aux femmes ! Avec le discours brut « homme égal femme », on se trompe… On a donc une vision d’égalité en toile de fond, que l’on n’incarne pas : cette affirmation est tout à fait fallacieuse. Prenez encore l’idée selon laquelle « l’homme est la seule espèce qui fabrique des déchets ». C’est encore fallacieux. Toutes les espèces produisent des déchets ; le propre d’une espèce, c’est de produire des déchets. Mais lorsque l’on a bien étudié ce qu’étaient les déchets de telle ou telle espèce, on a envie de revisiter nos déchets, de choisir ce que l’on produit ou non, et ceux que l’on produit, voire d’en utiliser certains.
– Cela ne va pas sans rappeler le débat sur l’énergie que nous vivons actuellement.
– Par contre, en ce qui me concerne, je ne vais pas sur ce débat. Je m’interroge plus particulièrement sur les déchets plastiques, ménagers, etc... L’ouvrage que j’écris en ce moment n’est pas facile à rédiger. Il se base sur tout ce que je sens de dysfonctionnel ou de bizarre, les préjugés, ou ce qui me paraît irréaliste dans notre façon de voir. Finalement, il s’agit d’aller au-devant d’une vision générale, d’une opinion en somme, qui me paraît dangereuse pour l’avenir, en tout cas certainement pas en phase avec ce que nous savons du monde. En fait, je n’y raconte pas qu’une belle histoire…
– Est-ce que vous y révisez le rapport nature / culture ?
– C’est ce que je dis en introduction : je fais le travail ingrat d’illustration de Descola[4] et de Latour[5] , ou même de Morizot[6]. Ce dernier effectue d’ailleurs un travail de terrain approfondi. En somme, je n’invente rien, j’essaye d’incarner une pensée que je trouve souvent encore un peu satellisée, en approche par rapport à la réalité organique dont nous sommes faits.
– Quelle partie exemplifiez-vous de Descola ?
– Une fois que l’on a dit avec Descola que l’opposition nature/culture n’est pas du tout une réalité, que fait-on ? Eh bien, il faut reconstruire une image de l’homme et de la société dans la nature. Et c’est ce que j’essaie de faire ; j’essaye de montrer en quoi il y a des liens, en quoi il n’y a pas de hiatus, et en quoi ces liens peuvent être vertueux ou non.
– Le travail est énorme !
– Oui, on ne peut pas tout faire, mais simplement on peut raconter plusieurs histoires plutôt saisissantes du monde et de nous-mêmes. Rappelons-nous l’histoire des médicaments[7]. Prenons un autre exemple : j’imagine que l’on trouve très vertueux, dans la pêche hauturière ou la pêche à pied, de ne retenir que les grosses prises et de relâcher les plus petites… Mais c’est une bêtise finie ! Cela nous a coûté, en dix ans, trois centimètres de réduction de taille moyenne chez les sardines à l’âge d’un an, et un poids divisé par 2 à 3 : finalement nous n’avons fait que sélectionner le nanisme de l’espèce ! Pour la pêche, il aurait finalement fallu puiser harmonieusement dans toute la pyramide des âges ! La réglementation nous met dans le pétrin.
– Très intéressant !
– Nombre de problèmes viennent de ce que nous voyons la nature et la réalité avec des yeux couverts d’écailles. Et les faire tomber, c’était le programme de Bachelard[8].
– Lui qui pense qu’il faut « psychanalyser nos sciences », c’est-à-dire les épurer de toutes nos projections psychologiques.
– Tout à fait. Et nous devons être surpris. Nous devons nous préparer à une révolution. La science coûte cher : si elle n’était destinée qu’à confirmer ce que nous savons, son utilité serait réduite. En outre, chaque fois que nous confirmons ce que nous savons déjà, nous nous enfermons dans l’idée que nos intuitions sont bonnes, et cela est très souvent faux. Donc, en plus d’être mauvais psychologiquement, ça l’est également économiquement. Nous ne paierions alors la recherche que pour confirmer ce que nous en attendons psychologiquement....
– Pour le coup il y a urgence.
– Le propos est très en retrait de ce qu’il faudrait faire.
– Faudrait-il en passer par l’éducation ?
– C’est en effet une autre de mes actions via la Fédération BioGée[9] que je préside. Nous organisons des exposés et des conférences pour montrer que nos disciplines sont génératrices de solutions. On ne peut pas éviter de croiser nos disciplines quand les problèmes surgissent et elles se retrouvent dans des situations de Cassandre : le malade ne peut pas affirmer que le docteur est dangereux lorsqu’il le voit à son chevet. A ce stade, il lui faut aussi admettre que le docteur est porteur de solutions. Et à ce titre nos disciplines ne dressent pas seulement le portrait de ce qui ne va pas bien, elles sécrètent aussi des solutions. Sauf que, s’agissant par exemple des sols, bien que les solutions existent, personne ne les connait, et personne ne les met en pratique… Quand on dit qu’il ne faudrait pas labourer, mettre des matières organiques plutôt que des engrais minéraux, ce sont des solutions, à la fois pour stocker plus d’eau, stocker du carbone dans le sol, et stopper l’érosion. C’est rationnel ! Nous sommes typiquement dans des gestes potentiellement porteurs de solutions. Mais ce que je constate, c’est que je ne suis pas convoqué par des gens qui me demanderaient comment mieux gérer les sols, et ainsi aller au-devant des problèmes de la société. Non, je ne suis convoqué que par des acteurs dont les sols sont à l’agonie. C’est le cas des Hauts-de-France par exemple, où nous sommes passés à des taux de matière organique tels que les sols s’écoulent après la pluie : il n’y a plus de liant !
– N’y-a-t’il pas un début de prise de conscience néanmoins ?
– Seuls 4 % de la SAU sont concernés par l’agriculture de conservation (qui ne laboure plus). C’est bien trop marginal. Ça n’est pas à la hauteur des enjeux du futur.
– D’ailleurs, dans votre livre, vous avancez la thèse qu’il suffirait d’enfouir 4/1000 du carbone produit par an pour rejoindre une neutralité du bilan carbone. La solution paraît facile ! Quels sont les freins à sa mise en application ?
– Il y a plusieurs choses. Premièrement, les gens ne réalisent pas forcément ce qui est en train de se passer. C’est la raison pour laquelle on a besoin d’expliquer les mécanismes qui sont en jeu. La deuxième chose, c’est qu’il y a une tension sur la matière organique. En effet, on a séparé l’agriculture de l’élevage. Donc, nous n’avons plus d’apport locaux de fumure d’origine organique ! Et cette tension redouble du fait de la méthanisation : la matière organique, aujourd’hui, nous en faisons de l’énergie, dont le digestat des stations est un produit minéralisé, et avec cela nous sommes alors dans une logique « d’engrais minéraux ». La matière organique a disparu pour être transformée en méthane.
En outre, nous n’avons pas assez formé les gens à l’idée que les vérités d’un jour et les pratiques enseignées pouvaient changer. On a appris aux agriculteurs à faire quelques gestes, comme labourer, inclure des minéraux, et ils l’ont fait. Ils ont cependant une réticence au changement parce qu’il ne leur a pas été expliqué qu’il s’agissait d’une pratique d’un moment, d’une époque. En quelque sorte, le discours insistait sur ce qu’il « fallait faire », affectant - qui plus est - le discours d’une connotation morale d’un poids très lourd. Des éléments langagiers l’attestent : on parle par exemple « d’un champ sale » lorsque celui-ci laisse apparaître des herbes. Certes, cela change un peu mais, au début, ce n’était vraiment pas le cas. Il y a des inerties culturelles, et l’on voit que l’on ne sait pas bien former la génération suivante. Nous savons très bien enseigner les certitudes que nous avons acquises, on ne sait pas comment enseigner ou acquérir les siennes propres.
– Voici qui est très subtil (ndlr : et qui parle à l’humble serviteur de la philosophie...)
– C’est-à-dire que je suis concerné au premier chef puisque impliqué dans la formation des futurs professeurs agrégés[10]. Toutefois, j’observe que souvent les programmes (malgré ma contribution à leur rédaction) ressortent plutôt de listes de connaissances que de méthodes de révision de nos connaissances.
– Ceci m’amène à la question suivante : comment pourrait-on faire entendre aux transnationales de l’agroalimentaire que quelque chose de très grave est en train de se dérouler dans nos sols ?
– Eh bien, je pense que ces entreprises sont dans leur rôle quand elles recherchent le profit à court terme. Elles n’ont que cela pour survivre. C’est plutôt la société dans laquelle elles sont qui doit s’interroger sur ce qu’elle taxe, sur ce qu’elle légifère, sur ce qu’elle permet, sur ce qu’elle accepte, sur ce qu’elle n’accepte pas ce qu’elle légifère, qu’est-ce qu’elle permet, qu’est-ce qu’elle accepte, ce qu’elle n’accepte pas. Sachant que l’acceptation, ce n’est pas qu’une question de règlement mais aussi de consommation. Par exemple, des personnes choisissent de se retirer des réseaux sociaux toxiques. Nous avons tous des problèmes à affronter, jusque dans nos gestes quotidiens, pour créer un cadre afin de vaincre un problème majeur. Par exemple, dans mon prochain livre, je consacre un chapitre à l’équilibre des biosystèmes. En réalité, aucun écosystème n’est jamais en équilibre : ils ont toujours changé, bien avant l’apparition de l’homme. L’homme n’est alors qu’un facteur de ces dynamiques qui ont toujours détruit et recréé de la diversité, ainsi que des fonctions. Sachant qu’il peut y avoir un solde positif ou négatif à tout cela, en terme en particulier de biodiversité ou de vivabilité de ces écosystèmes pour l’homme. Le solde de l’homme ... est plutôt négatif. Le mythe de la stabilité des écosystèmes n’est que la transposition à la truelle du mythe du Jardin d’Éden...
– Oui !
– ... Ce que je propose, ce sont deux concepts importants. Le premier, c’est une notion de « capacité biotique », qui devrait vraiment occuper notre esprit lorsque l’on pense écosystèmes. Et l’autre concept, c’est celui de la « tragédie des biens communs ». Je ne sais si cela vous dit quelque chose ?
– Non.
– C’est assez fondamental : prenons la capacité biotique, c’est-à-dire la quantité de biomasse ou de ressources qu’une espèce d’un écosystème peut obtenir de manière durable de celui-ci, et au-delà de laquelle il risque de s’éteindre. L’exemple du lemming est une excellente illustration. S’il meurt, ce n’est pas parce qu’il se précipite à l’eau, contrairement à la légende urbaine, mais c’est juste parce qu’il a trop proliféré. La capacité biotique correspond à ce que l’on peut faire dans un endroit, de façon soutenable, sans abîmer la capacité de cet endroit, et permettre la survie de l’espèce. On peut songer au fameux « jour du dépassement », qui est en fait celui où l’humanité dépasse la capacité biotique terrestre. Or, comme nous venons de le voir, il se trouve que l’homme n’est pas le seul à dépasser les capacités biotiques ! Mais à quel prix…
Le second concept, c’est celui de la tragédie des biens communs. Cela arrive dans les systèmes dotés d’un « bien collectif », dont à court terme, le bénéfice de surexploitation individuelle est supérieur à l’intérêt collectif à long terme. Donc nous l’abîmons rapidement plutôt que de le préserver à long terme. Par exemple, émettre du CO2 : chacun le fait pour une raison avantageuse à court terme en détruisent l’avenir collectif. Les lemmings, en mangeant, ne font rien d’autre…
– C’est très clair.
– En fait, il y a plusieurs exemples biologiques. L’idée que celui qui a la plus grande descendance « gagne » est encore en vigueur. Or, se reproduire massivement, c’est abîmer le bien commun. Et cette attitude n’est pas propre à l’être humain, elle est générale. Ce qui est humain par contre, c’est qu’on n’a pas compris ce concept à grande échelle et dans toute sa dimension, c’est-à-dire que l’intérêt collectif à long terme est très souvent à l’opposé de l’intérêt individuel, à court terme celui-ci, et sans cadre aucun. L’intérêt individuel à court terme l’emporte donc sur le reste de l’intérêt collectif. Nous aurions en réalité plutôt intérêt à organiser la suite, et j’en reviens à cela : il faut gérer ! Prendre connaissance de l’intérêt qu’ont les grandes entreprises, comme Exxon Mobil par exemple, à cacher les scénarios de changement climatique qu’ils ont très bien modélisé. Ou bien de l’intérêt de Monsanto à cacher la toxicité du glyphosate, alors même qu’elle sait très bien ce qu’il en est en interne, c’est un intérêt à court terme. D’ailleurs, entre parenthèses, même ces entreprises payent ensuite le prix à long terme puisque désormais elles sont montrées du doigt. Mais on est encore loin de les faire payer à la hauteur de ce qu’il faudrait qu’elles rendent. Les conséquences sont là : nous sommes devant une mise en tension entre le court et le long terme. Il faudrait résoudre cette fracture ; cela ne se fera que par un arsenal législatif.
Et puis peut-être, revenant sur la question de l’éducation, ce sur quoi je m’interroge de façon très ouverte, est la notion de « tabou ». Je m’explique. Il y a des choses que l’on ne fait pas intuitivement, qui sont réputées « taboues ». Et je trouve que nos tabous sont mal organisés. Par exemple, il y a un tabou à se déshabiller devant les autres. La question que je me pose est de savoir si ne pourrions pas, dans l’éducation des plus jeunes, faire en sorte que « jeter du plastique dans la nature » soit à son tour tabou, au même titre que la nudité en public ? Entre la construction de tabous individuels et la constitution de règles collectives, il y a peut-être des leviers d’action.
– Un nouvel impératif moral à la manière de Kant, écologique en quelque sorte, mais adressé à la nature ?
– Ou bien Hans Jonas ? (rires)
– Également, en effet, le « principe responsabilité »[11].
– Tout à fait ! Ça paraît un peu mou de parler de morale à la fin… En effet, ce n’est plus à la mode, ça ne paraît pas efficace. Mais en réalité, je ne vois pas d’autre levier.
– S’agissant de morale, à titre personnel, j’y crois... Du reste, cela me fait songer à la notion du doute que vous abordez dans un passage que j’ai beaucoup aimé de votre livre, (ndla : « L’Origine du Monde »). Le « court-termisme » et les tensions résultantes, notamment dans industrie - santé, ont fait naitre un doute volontairement néfaste à la manifestation de la vérité scientifique, alors que précisément, le doute cartésien était un doute méthodologique, destiné à accoucher de sa vérité absolue. Il y aurait donc peut-être une éducation à ressaisir sur ce point-là aussi ?
– Oui, mais ce sera dur à organiser, et l’école n’organise plus rien désormais non plus. Il faudrait être pragmatique. Je pense qu’il faudrait que l’on puisse étendre l’école aux réseaux sociaux. Par exemple, récemment auditionnée à l’Assemblée Nationale sur l’éducation, j’ai tenté de passer cette idée que demain, notre investissement auprès des jeunes ne pouvait pas se limiter à ce qui se passe dans les lycées et les collèges. Il faut désormais une présence électronique. Il faut référencer des contenus, soutenir des contenus, des Youtubeurs. Il faut être actif, créer des matériaux qui mobilisent les esprits en dehors de l’école aussi.
– Puis-je vous demander à quel titre vous êtes intervenu auprès de l’Assemblée Nationale ?
– Eh bien en tant que président de la Fédération BioGée, lors d’une session de la Commission des Affaires Culturelles et Sociales.
– Peut-on résumer cela en affirmant qu’il faudrait maintenir la pensée en acte ? Plutôt que la laisser en puissance ? Certes l’éducation a son mot à dire sur ce point, mais faut-il par exemple créer des maisons de réflexion citoyenne, des maisons de la philo, des commissions pluridisciplinaires, des maisons écosophiques, c’est-à-dire : est-ce qu’il ne faut pas plutôt impliquer, rendre acteur de l’évolution, puisque vous parliez d’évolution plutôt que de transition ? Il me semble qu’il y a tout de même une demande croissante sur ces questions. Il y a bien sûr la nécessité de changer nos habitudes, dans le quotidien mais, je crois également qu’il y a une envie de penser.
– Je ne suis pas fondamentalement convaincu qu’il y ait une prise de conscience générale aujourd’hui. Cela relève plutôt d’un biais socioculturel, limité mes copains, à commencer par vous, si je puis vous affubler de ce titre...
– (moi riant) Mais je vous en prie, c’est un honneur !
– .... Ils sont à fond là-dedans ! Mais bon, il y a encore du plastique au bord de la route ! Et ce ne sont pas mes copains qui le jettent… Voyez-vous, dans notre « ghetto socioculturel » tout va bien… Et puis dans notre pays, peut-être que cela va à peu près. Quid des autres ghettos socioculturels, et quid des autres pays ? Quand on voyage, on n’a pas l’impression que tout le monde en est arrivé aux mêmes conclusions. Nous avons résolu un certain nombre de problèmes dans notre pays qui sont loin d’être résolus par ailleurs. C’est-à-dire que, lorsqu’un pays est en guerre, lorsqu’un pays a faim, ne pas recycler ses ordures ou les obus... vous me comprenez.
– En effet, pour des raisons culturelles, la Chine, par exemple, n’a pas du tout le même regard que nous sur la nature…
– Oui, comme le dit l’un des rédacteurs du club de Rome, ceux qui ont fait allusion à la croissance finie du monde[12] : nous sommes loin de distinguer les gestes et les réactions qui entretiennent la dépendance de ceux qui en libèrent. Typiquement, quand il a fait chaud en Inde, on rouvre les mines de charbon pour faire tourner les systèmes de climatisation.... Il faut distinguer les réactions adaptatives des réactions addictives. Dans chaque pays, on a plutôt des réactions addictives qu’adaptatives.
– Vous parliez de révolution…
– Bien sûr qu’il en faut une ! Tout ce que nous avons vu, c’est que les générations se sont succédé et que rien n’a changé. La conclusion logique de tout cela, c’est que le réformisme a raté et que, je le crains, ça va se terminer dans un bain de sang. Que ce soit pour les progrès sociologiques, des droits de l’homme, pour les progrès politiques, rien n’a jamais été le produit d’une réforme, mais bien de révolution. La dernière fois qu’il y a eu une révolution en France, on ne s’en est pas rendu compte parce qu’il y avait une guerre en même temps, c’est la Libération : pas douillet comme évolution. On se rend mal compte qu’une pensée du centre avait tué l’extrême droite parfois dans le sang. Il y a quand même eu des morts à la Libération, que je sache ! Donc, sur ce terrain socio-politique, la réforme n’a jamais vraiment eu lieu. On est en train de voir que, sur le terrain écologique, elle ne parvient pas à faire grand-chose non plus. Elle ne va pas à la vitesse de l’inventivité de ceux qui ont une efficacité à court terme, je reviens ici à la tragédie des biens communs.
La deuxième raison pour laquelle il faudrait une révolution, c’est que, plus on attend, plus on aura de problèmes à gérer en même temps. On nous dit : « Il faut suspendre toutes les mesures agri environnementales parce qu’il n’y a plus assez à manger à cause de la guerre en Ukraine » Mais oui ! Pourquoi a-t-on donc tant attendu pour les mettre en branle ? On se retrouve à gérer plusieurs problèmes en même temps. Or ceci très dangereux : en effet, nous pouvons gérer un problème à la fois, mais certainement moins facilement plusieurs en même temps. Alors ne tardons pas plus. Reprenons les raisonnements évolutifs : de même que la médecine tient dans la gestion de l’évolution des microbes pathogènes, de même l’agriculture tient dans la gestion de l’évolution des microbes pathogènes et des mauvaises herbes. Que fait-on à ces germes, à ces herbes, et comment évoluent nos gestions ? On sait très bien qu’une bonne stratégie est une stratégie faite de luttes multiples. Je donne deux exemples.
Premièrement celui des rizicultures traditionnelles chinoises, où les champs offrent une telle diversité génétique que les pathogènes, lorsqu’ils sont adaptés à une espèce, ne peuvent attaquer la voisine, parce que trop différente. Ils ne se propagent donc pas. Second exemple, celui de la trithérapie en médecine. Désormais, on prescrit au patient trois drogues en même temps contre une bactérie ou un virus. Pour y résister, ces derniers devraient développer trois résistances en même temps. Ce qui paraît statistiquement improbable sur une population normale de virus, et donc le virus ne peut trouver de répondre. Mais, en fait, nous sommes en train de nous infliger cela à nous-mêmes, que ce soit par les multiples produits chimiques que l’on répand dans notre environnement, ou bien par le fait que l’on ne résout pas les problèmes qui se présentent à nous les uns après les autres. Nous en arrivons ainsi à une situation qui devient tellement complexe qu’une forme de révolution s’impose presque d’elle-même pour en sortir.
– C’est très clair. Finalement, que diriez-vous à un jeune ingénieur agro ?
– Je ne lui conseillerais pas de « bifurquer » au sens strict[13]. Je connais personnellement des gens qui avaient bifurqué bien avant les agros de 2022. Une de mes anciennes thésardes, qui avait fait Normale Sup, et s’est finalement s’installée dans une exploitation agricole. Elle accueille du public et s’est lancée dans la production agricole. Ceux qui « bifurquent » ont certainement des rôles de lanceurs d’alerte, mais voyons ce qu’ils seront dans 15 ans. Ils auront pris des responsabilités syndicales, ou bien d’élus. Il faut qu’ils valorisent leur savoir-faire, même autrement !
Car je pense que, lorsque l’on a acquis un certain savoir-faire, cela implique deux choses. Premièrement, une certaine dette envers la société qui a investi en vous, pour vous donner ce savoir-faire, et deuxièmement, des façons d’agir qui sont au-delà du potentiel commun. C’est-à-dire, qu’ils ont des leviers que n’ont pas les autres gens. Donc je les encourage plutôt à être les fers de lance d’une autre agriculture, en pleine possession de leurs moyens techniques, c’est-à-dire de ne pas quitter le domaine, de ne pas quitter le statut de cadre, qui est un statut d’organisateur et de concepteur, et d’utiliser pleinement leur savoir-faire pour cela. Nous évoquions tout à l’heure l’éducation et ses programmes. Pour la deuxième fois, je viens récemment d’intervenir dans la modification des programmes scolaires des classe préparatoires de biologie (les BCPST). En 2012, nous avions pour la première fois déjà introduit des notions d’écologie et d’évolution : il n’y en avait pas. Un de mes collègues des classes prépa s’était posé la question de savoir « à quoi sert aux futurs vétérinaires et aux futurs agros, d’avoir des notions d’écologie et d’évolution ». Je pense que cela allait éviter des propos ineptes, des apories comme cela. Cette fois-ci, nous sommes allés encore plus loin puisque, désormais, il y a des chapitres sur l’évolution du climat, les sols, au détriment partiel d’approfondissements excessifs du biologique purement physiologique, ou de la biologie moléculaire. Et donc ces modifications de programme font que nous fournissons aux écoles d’ingénieurs des élèves qui ont une vision un peu plus systémique, une compréhension globale plus que des connaissances. C’est un changement par rapport aux programmes anciens, ce qui peut leur permettre de se poser des questions.
Tout à l’heure, nous parlions du doute. J’aurais dû préciser qu’il faut douter pour vivre et non pas vivre pour douter. Et il est important qu’à un moment la remise en question ne détruise pas tout. Sinon on tombe dans le conspirationnisme, et la négation de toutes les valeurs, c’est-à-dire le nihilisme. Si l’on reprend Descartes, dont je ne suis pas un expert, il doute du sensoriel, ce qui lui permettra d’arriver à une chose sûre, ou en tout cas vers ce qu’il va considérer comme assez sûr pour bâtir sa philosophie. C’est qu’il pense, et que c’est une preuve qu’il existe. Transmettre le doute, on ne sait pas bien le faire. Et désormais, lorsque les gens travaillent le doute, ils ne comprennent pas ce qui se passe et retombent dans le nihilisme. Donc, aux jeunes agros, je leur dirais de bien garder ce qu’ils savent, de ne pas tout nier, et de promouvoir les formes d’agriculture qui sont en phase avec ce dont nous parlons.
– Une dernière question si vous le voulez bien, sous forme de jeu, une expérience de pensée. Vous êtes membre d’un corps expéditionnaire interplanétaire, vous arrivez sur une planète où vit une nature assez semblable à la nôtre, habitée par des humanoïdes qui n’élèvent ni ne cultivent. Leur apprenez-vous l’agriculture ?
– Déjà la question du contact se pose. Les échanges de maladies sont toujours potentiellement là. Dans l’histoire des contacts entre les blocs d’humanité qui n’avaient jusqu’alors pas beaucoup d’échanges on a connu de grands déboires. Avant tout, j’aurais peur des microbes, tant pour eux que pour moi.
– Très clair, je n’y avais pas pensé.
– Si le contact est fait cependant, que ce soit des alter-ego en tous points, leur apprendrais-je l’agriculture ? Je regarderais probablement d’abord ce qu’ils font, avant de me demander si l’on doit leur apprendre quelque chose. Je vous donne un exemple : je suis au conseil d’administration de la Société Française d’Agroforesterie. Je crois très fortement en cette méthode que je pense tout à fait capable d’augmenter la biomasse produite sur une surface donnée. J’y crois aussi parce qu’elle permet de mitiger des effets climatiques et de créer des écrans à la dispersion des maladies. J’y crois énormément. Et puis, vous avez compris que dans mon livre sur le sol, j’affirme qu’il ne faut pas labourer. Des arbres sans labour : est-ce que cela ne vous évoque pas quelque chose ? Cela s’appelle l’agriculture amazonienne, qui survit dans les jardins créoles.
– J’y pensais.
– Lorsque nous sommes, nous autres Européens, arrivés en Amérique du Sud, nous aurions peut-être mieux fait de nous demander qui avait la meilleure pratique, si finalement nous avions raison dans nos pratiques. En fait voilà, mon deuxième réflexe, serait de me demander si finalement nous n’avions pas des choses à apprendre. À partir de là, nous pourrions peut-être dresser un bilan et nous demander si nous n’aurions pas des choses à apprendre d’eux. Ça n’est pas impossible !
– Très intéressant !
– Ça s’appelle une révolution sociologique comme disait l’autre… Et c’est ce qui nous a manqué, c’est ce qui construit la pensée d’un Lévi-Strauss par exemple. Finalement, ce que je fustige ici comme ce que je fustige à travers notre vision de la nature, c’est cette incapacité à saisir l’altérité. D’ailleurs, c’est un des chapitres de mon prochain livre. Par exemple, j’évoque la notion d’intelligence des plantes, qui est une vaste blague. Les plantes sont certes adaptées, oui bien sûr, mais utiliser « intelligence » pour le dire, c’est juste essayer de voir le « différent » comme un autre soi-même. Ça n’aide ni à voir ce qu’est l’autre, ni à voir comment on peut le gérer. Il faut donc voir l’autre comme un autre, la plante comme une plante, la bactérie comme une bactérie, l’écosystème comme un écosystème, et une autre population comme une autre population. C’est simplement de penser à ne pas trop ramener à soi. Or, derrière cette question : « Vais-je leur enseigner l’agriculture ou non ? », je vois poindre ce biais-là. Votre question était faussement naïve, j’imagine.
– Marc André SELOSSE je vous remercie vivement !
[1] Le microbiote est l’ensemble des micro-organismes vivant en communauté dans le système digestif, qui comprend à la fois les bactéries mais aussi les virus
[2] M.-A. SELOSSE, 2019. Les goûts et les couleurs du monde. Une histoire naturelle des tannins, de l’écologie à la santé. Actes Sud, Arles, 358 p.
[3] 2024
[4] Philippe Descola : anthropologue français
[5] Bruno Latour : français, sociologue, anthropologue, théologien et philosophe des sciences, 20ème et 21ème siècle.
[6] Baptiste Morizot : philosophe français, dont les recherches portent sur les rapports entre l'humain et le vivant en général.
[7] Surdosage donnée aux femmes puisque testé sur des hommes
[8] Gaston Bachelard, philosophe français des sciences, qui avançait la nécessité de faire.
[9] BioGée : https://www.biogee.org/ fondation dont Marc André SELOSSE est le, président, et dont le rôle est de fédérer les acteurs en lien avec les sciences et technologies du vivant, les sciences de la terre et de l’environnement ; de promouvoir la formation des citoyens aux sciences du vivant, ainsi que la formation des futurs enseignants ; de remettre la science entre les mains des citoyens.
[10]Marc André Selosse a formé à peu près la moitié des agrégés actuels de France, et cela fait 30 ans qu’il est impliqué dans les programmes de l’Education Nationale.
[11] Hans Jonas, « Principe Responsabilité, ouvrage majeur de l’auteur paru en 1979
[12]Les écologues Donella Meadows et Dennis Meadows en 1972
[13]Allusion aux dernières réactions de quelques étudiants de Paris Agro Tech, qui ont décidé de sortir du système



